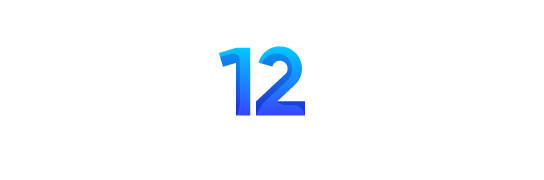En mars dernier, Nazaire Joinville a soutenu avec mention « excellent » son mémoire de maîtrise à l’Université Sainte-Anne, au Canada. Intitulé « Langue, musique populaire et identité : comprendre les dynamiques sociolinguistiques de la diaspora haïtienne à travers le prisme du Compas », ce travail s’inscrit dans une démarche originale mêlant linguistique, musique et identité culturelle.
Supervisée par la professeure Chantal White, cette recherche sur la musique compas (Konpa) vise à explorer deux axes majeurs : d’une part, la manière dont le Konpa, genre musical emblématique d’Haïti, reflète la réalité sociolinguistique du pays et de sa diaspora ainsi que les idéologies linguistiques qui en découlent ; d’autre part, la manière dont les artistes et les mélomanes en diaspora interagissent avec les langues véhiculées dans les chansons, et ce, en lien avec leurs environnements sociaux respectifs.
Ancrée dans une perspective ethnomusicologique, cette étude met en lumière le rôle central du Konpa dans l’expression des identités linguistiques et culturelles haïtiennes, tant en Haïti qu’au sein des communautés diasporiques.
Par ailleurs, cette recherche s’articule autour de quatre axes. Le premier, l’image de la situation sociolinguistique haïtienne reflétée par les chansons, vient ensuite l’influence des langues utilisées dans les chansons Konpa sur la réception des mélomanes de la diaspora. Le troisième et le quatrième axes portent sur les facteurs guidant le choix des langues des musiciens dans les compositions musicales et les représentations linguistiques des acteurs du konpa.
Une méthodologie rigoureuse
Le travail de terrain a été réalisé dans deux pôles majeurs de la diaspora haïtienne : Montréal et Miami. Afin de garantir une approche complète, le chercheur Nazaire Joinville a opté pour une triangulation méthodologique : Une analyse linguistique des paroles de chansons Konpa, mettant en lumière les langues utilisées et les idéologies sous-jacentes aux choix linguistiques ; deux focus groups de huit mélomanes dans chacune des deux villes ; huit entretiens semi-directifs menés auprès d’acteurs clés de la scène Konpa (trois à Montréal et cinq à Miami) et une observation participative de deux événements musicaux majeurs : le premier concert du groupe Zafem à Montréal, le 27 décembre 2023 à la Gare Windsor, et la première édition du festival Konpa Kingdom, tenue au Barclays Center de Brooklyn, à New York, le 31 décembre 2023.
Ce qui confère à cette étude sa légitimité, c’est qu’elle intègre l’ensemble des composantes de l’industrie musicale haïtienne : les artistes, les journalistes, les animateurs, les mélomanes et bien sûr les œuvres musicales elles-mêmes, précise le professeur Joinville, soulignant que cela lui permet de comparer les discours entre eux et avec les productions musicales.
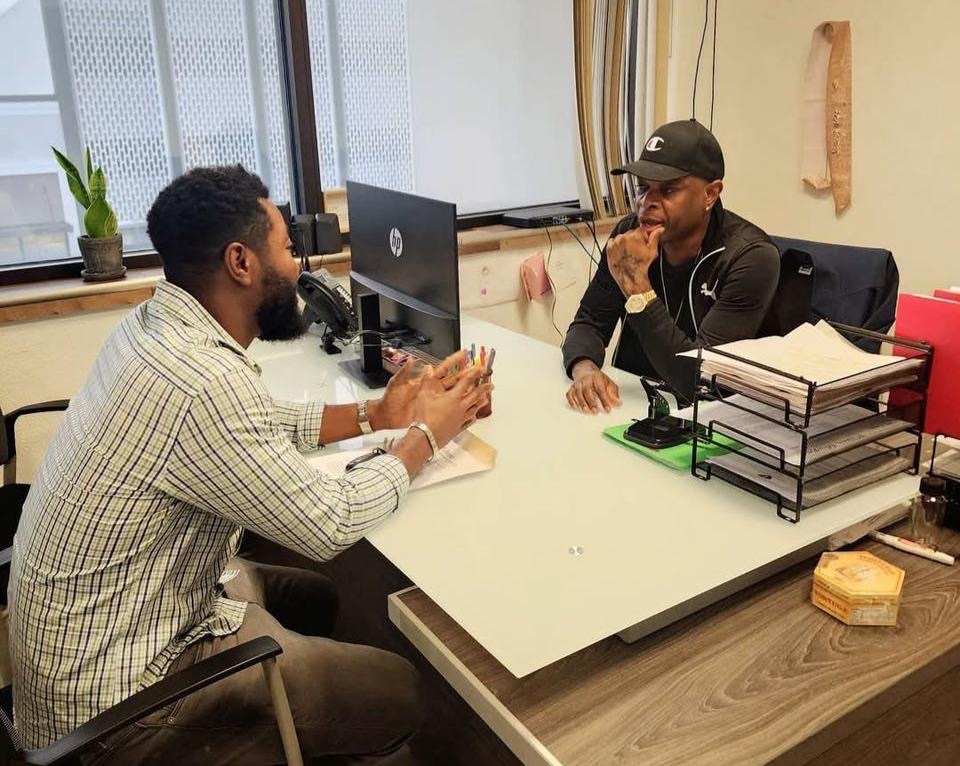
Pourquoi inclure la diaspora ?
Le choix de la diaspora haïtienne, en particulier celle de Montréal et de Miami, s’inscrit dans une logique bien réfléchie. Pour le sociolinguiste, ces milieux, bien que multiculturels, conservent un fort ancrage identitaire haïtien. Le Konpa y est particulièrement présent et joue un rôle important dans la vie culturelle locale.
« Mon étude porte sur les liens entre l’identité haïtienne fortement incarnée par le Konpa et les dynamiques linguistiques spécifiques que l’on retrouve au sein des diasporas, notamment dans ces deux villes », précise-t-il.
Des résultats riches en enseignements
Cette recherche met en évidence le rôle fondamental de la langue dans les processus de construction identitaire des Haïtiens vivant en diaspora. Elle révèle aussi comment les conflits linguistiques existant en Haïti trouvent un écho direct dans la musique populaire, qui devient alors un espace d’expression et de négociation identitaire.
L’étude accorde une place centrale au groupe Zafem et à son album Lalin ak Solèy, sorti en mai 2023. Ce projet musical est présenté comme une œuvre qui sublime le créole haïtien, à la fois dans sa richesse poétique et dans sa portée symbolique. L’album joue un rôle essentiel dans les représentations linguistiques des mélomanes interrogés et dans leur attachement au Konpa.
En somme, ce mémoire s’inscrit dans la continuité des recherches de Nazaire Joinville. Déjà, pour son mémoire de licence en communication sociale à la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’État d’Haïti (FASCH/UEH), il avait étudié les chansons de l’artiste Arly Larivière. Depuis, il a publié plusieurs articles scientifiques sur le Konpa dans des revues canadiennes et donné diverses conférences sur le sujet dans des universités du pays.
Nazaire Joinville invite la communauté universitaire à approfondir encore davantage l’étude du Konpa, de la diaspora et de la culture haïtienne dans leur complexité et leur richesse.
Edwardo Pierre